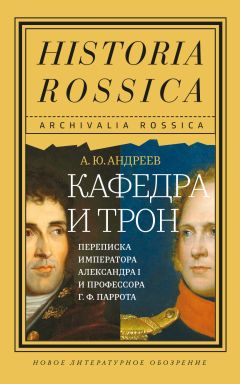
Автор книги: Андрей Андреев
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 92 страниц) [доступный отрывок для чтения: 22 страниц]
89. G. F. Parrot à Alexandre IER
[Saint-Pétersbourg], 24 janvier 1806
Je ne puis quitter Pétersbourg sans Vous écrire encore une fois. Votre image me suit partout. En vain je veux l’éloigner, en vain je veux me reposer sur la Providence, Vous confier à Elle. Je ne le puis. Être chéri! La Divinité me paraît presque un trop faible garant pour Vous. Écoutez la voix de Votre ami. Il me semble que c’est la dernière fois que je Vous parle.
L’incertitude, l’avant-coureur certain des malheurs, règne dans Votre Ministère. Les opinions sont partagées et chacune d’elles est vague. Des factions de cour se forment à la sourdine et paralysent le zèle de Vos fidèles. Vous êtes sur la défensive tandis que Vous devriez attaquer. Ralliez-Vous à ce que Vous avez du meilleur, à Novossilzoff, Czartorisky, Kotschubeÿ. Mettez Klinger au nombre de ces Affidés, Klinger qui a l’âme forte et du génie. Ne remettez pas au lendemain. Rassemblez-les dès aujourd’hui. Parlez-leur avec cet enthousiasme de la vertu, avec ce sentiment de Vos devoirs que Vous concentrez peut-être trop depuis quelque temps. Échauffez leur âme, présentez-leur le tableau de la situation de l’Empire, faites-leur sentir la nécessité d’agir avec vigueur, et que chacun d’eux Vous jure solennellement de prendre, d’appuyer, d’exécuter de toutes ses forces le parti que Vous prendrez. Puis appointez-les au lendemain. Qu’alors chacun parle et soutienne son avis de tous ses motifs. Après cela délibérez seul avec Vous-même, et que Votre décision soit exécutée avec zèle et promptitude.
Il faut donner une secousse à la marche des affaires. Elle a été déjà donnée au dehors. Si Vous ne Vous mettez pas au pair à l’intérieur, Vous succomberez. Six semaines sont déjà perdues. Six heures seraient de trop. Le plus actif des hommes, le plus terriblement conséquent, ne peut être vaincu que par ses propres armes. Donnez plus de temps au travail. Si la journée Vous suffisait pendant la paix, allongez la journée dans ce moment de crise. Laissez à l’intérieur le temps qu’il a toujours eu, et prenez sur les autres heures ce qu’il Vous faudra pour l’extérieur. Que chaque jour le conseil des fidèles ait séance; que chaque jour soit marqué par leur activité, dont rien ne doit ralentir la marche. Écrivez Vous-même le protocole des séances. C’est le plus sûr moyen de Vous saisir du fil des opérations, de Vous accoutumer au vrai travail, d’en donner la passion à Vos amis.
Je sais combien je Vous demande. Mais Vous êtes à la fleur de l’âge, au période de la vie qui déploie le plus de force. Si aujourd’hui Vous ne devenez pas mon Héros, jamais Vous ne le serez. – Vous voyez que j’écrase toutes les convenances, à dessein. Je veux allumer le feu de Votre génie étouffé sous la pourpre. Pourquoi Vous aimerais-je? Je suis ambitieux, pour Vous. Si la Providence eût voulu me placer en France, le tyran ne la gouvernerait pas; la liberté, la dignité de l’homme y régneraient. Mais je n’y eusse pas trouvé une âme comme la Vôtre, et je bénis ses décrets. Régnez, et confondez le méchant. Voilà ce que me dicte ma passion pour Vous. Il a été un temps où le premier de mes vœux était de mourir à Vos côtés. À présent c’est le moindre. Si l’heure sonne, Vous me verrez à mon poste. Du reste jamais je ne Vous approcherai que comme j’ai fait jusqu’ici. Je dois être éloigné de Vous, pour Vous-même et pour moi. Votre physionomie touchante, Votre cœur séduisant saisissent trop mon âme. En Votre présence j’oublie trop aisément que Vous êtes Empereur pour m’abandonner au sentiment de l’amitié. Comptez sur ce que je Vous dis de moi-même. Moi, je puis m’y fier. J’ai été à l’école du malheur.
L’obscurantisme veille à Votre porte. Il attend que Vous commettiez des fautes à l’extérieur pour Vous en imposer à l’intérieur. Des êtres pusillanimes épient le côté faible que Vous pouviez leur prêter dans Vos relations personnelles les plus intimes1, se glorifient de leurs succès et se rallient aux ennemis de la lumière. Devenez sévère, frappez de crainte les ennemis du bien. L’occasion s’offre de donner un exemple. Punissez Arsenief pour avoir osé, chargé de crimes et de honte, briguer un poste de confiance et trahir ses devoirs dans cet emploi.
Visitez les tribunaux. Veillez à l’exécution des Ukases, punissez les délais. Ne Vous laissez pas rebuter par des essais infructueux. Vous parviendrez au but difficilement, mais Vous y parviendrez.
Visitez les prisons et les hôpitaux, ne fût-ce que pour voir la misère humaine et préserver Votre âme de cette tolérance pernicieuse qui séduit la bonté à tolérer les abus.
Réformez l’armée. Substituez les manœuvres à l’exercice. Vos officiers s’y feront, dès qu’ils sauront que c’est le moyen de Vous plaire. Il faut commencer une fois, sans quoi les officiers ne se formeront jamais.
Voilà ce que je voulais Vous dire. Puisse chaque mot Vous pénétrer comme il m’a pénétré! J’ai rempli le plus sublime devoir. Mon cœur en est si content! Une larme d’attendrissement mouille mes paupières. O mon Alexandre! – Écrivez-moi deux mots. Que je sache l’état de Votre âme avant de partir.
90. G. F. Parrot à Alexandre IER
[Dorpat], 1 février 1806
Mon Alexandre ne m’a pas écrit ce peu de mots qui eussent fait tant de bien à mon cœur. Je l’en avais prié dans ma dernière lettre de Pétersbourg. Êtes-Vous faché? Non, affligé? Le style de cette dernière lettre Vous a paru trop violent. Si Vous saviez combien il m’en a coûté pour Vous écrire sur ce ton. Je me suis enserré; je me suis dit: je veux Lui écrire avec fermeté; plutôt de la dureté que de la mollesse. Je veux oublier un instant que je L’aime.
Ce que Vous m’avez dit sur l’expression trop molle de quelques-unes de mes lettres m’a frappé. Je tâcherai de me corriger. Je sais que je n’y parviendrai pas. Mais au moins je le fais quelquefois. J’ai vu l’amitié. Je l’ai vue sincère et cependant l’égoïsme à sa suite, un égoïsme bien secret, bien caché, mais cependant de l’égoïsme. J’ai tâché d’en purger mon âme, depuis 4 ans que je Vous connais. Votre cœur si pur, si vertueux m’a facilité le triomphe sur cet ennemi du vrai sentiment, et c’est ce triomphe qui me donne la force de Vous écrire quelquefois avec dureté.
Pourquoi ne m’avez-Vous pas écrit? Quelques mots. Je ne demande pas des lettres longues et détaillées. C’est à moi de Vous les écrire. Je commande à mon temps, à mon sommeil, à ma santé. Je suis l’élève du malheur. Vous ne l’êtes pas encore. Mais je voudrais que ses premières leçons Vous fassent utiles. Je ne Vous demande que quelques mots, et si j’interroge mon cœur, il me répond que c’est pour Vous, oui pour Vous, que je les demande. Sondez le cœur humain, sondez Votre cœur, et Vous trouverez que rien n’est si salutaire pour l’homme bon qui veut être vertueux en dépit des circonstances qui le tyrannisent, qui minent sa force, son activité, son passion pour le bien, que de se lier vis-à-vis d’un ami sûr, dont il respecte la vigilance. C’est une des principales règles de ma vie. Je pèse les motifs de mes actions, je me détermine et je mets un ami dans ma confidence. Alors plus de retraite. L’estime pour cet ami m’impose la loi de ne plus fléchir. C’est ainsi que l’égoïsme, que la nature ne nous a pas donné pour nous avilir, doit être mis à profit pour le bien. Croyez-moi. Il n’est nul homme au monde, peut-être pas même Jésus, Socrate ou Régulus, qui n’ait besoin de ce ressort pour tenir son âme dans cette vigueur de principes que l’humanité a déifiée en eux. Régulus trouva dans la résistance du serment la résistance qu’il dut opposer au cri de la nature et de sa famille. Socrate se soumettant aux lois injustes de sa Patrie, mourant pour ne pas cesser d’être citoyen, était entouré de ses amis; et Jésus trahi, vendu, crucifié encourageait ses disciples à la vertu et consolait sa mère.
Rapproche-toi de ton ami, Alexandre! Presse-le sur ton cœur, non seulement dans ces moments d’effusion où la présence, où le langage de l’âme exalte le sentiment. Qu’il te soit toujours présent. Vois-le toujours à tes côtés, confies-lui tes plus secrètes pensées, et quant il te prie de lui en dire quelques-unes, ne le lui refuse pas, pour toi-même, pour le bien de ton peuple, pour ta propre vertu.
O que je me réjouis d’avoir une âme entreprenante qui lutte sans cesse contre la faiblesse de tes alentours. Agis! fût-ce quelquefois à tort. – Pourquoi la Gazette de Pétersbourg n’a-t-elle pas encore livré l’article1? Il ne remplissait peut-être pas tes vues. Il ne satisfaisait pas à tout. Mais faut-il n’agir que comme la divinité? La perfection est-elle l’apanage de l’homme? Agis! Ce n’est pas moi seul, c’est Bonaparte qui te crie du sud-ouest de l’Europe: Agis. Vois ses succès. Crois-tu qu’il ne commet pas de fautes? Elles ne cessent de l’être que parce que tous les autres en commettent de plus grandes, la plus grande de toutes, l’inactivité.
L’idée de Vous rallier à Vos alentours a peut-être ses inconvénients. Quelle mesure n’a pas les siennes? Vous ne Vous croyez pas un Dieu. Il Vous faut donc des yeux, des bras, des hommes pour voir, pour agir, pour mener les hommes. Ceux que je Vous ai nommés sont les meilleurs. Servez-Vous donc des moyens que la providence, que Votre sens interne Vous a donné. Votre grandeur consiste en cela.
Adieu, mon cher ami, mon précieux Alexandre! Ton Parrot est toujours près de toi.
91. G. F. Parrot à Alexandre IER
[Dorpat], 16 mars 1806
Sire!
Depuis 6 semaines que j’ai quitté Pétersbourg j’attends quelques lignes de Votre main. Peut-être ai-je tort de les désirer avec tant d’ardeur. Mais le sentiment calcule-t-il? Et Vous, qui connaissez si bien ce sentiment, cette sollicitude pour tout ce qui Vous concerne, Vous pouvez me refuser cette jouissance. Craignez-Vous une indiscrétion de ma part? J’ai brûlé Votre première lettre dans un temps où je n’espérais pas revoir ces caractères chéris1.
Mon vœu favori, le plan des écoles paroissiales languit. L’opinion des provinces est remise aux diètes prochaines. Le temps s’écoule et l’ennemi l’emploie à décréditer d’avance cette institution chez les paysans. On leur fait croire que ces écoles sont destinées à forcer des recrues pour le militaire. On a même déjà recruté des maîtres d’école et des écoliers. Les amis de la bonne cause, qui ont d’ailleurs déjà le dessous, perdent courage parce qu’ils voyent que rien ne s’effectue. Il est indispensable de prononcer Votre volonté par un acte décidé. Car il s’écoulera sûrement encore plus d’une année avant que toutes les difficultés qu’on fera contre les écoles paroissiales elles-mêmes soient levées. Veuillez, je Vous en supplie, décréter l’établissement préliminaire des séminaires où les maîtres d’école seront formés. Ces séminaires sont parfaitement indépendants du plan ou de l’exécution des écoles paroissiales. Quelque forme que celles-ci ayant, il faut former des maîtres. Pendant ce temps-là on pourra disputer à loisir sur les écoles elles-mêmes, et Vous aurez par là témoigné Votre volonté décidée pour leur établissement. Je joins ici une copie des § du plan des écoles paroissiales concernant les séminaires. Veuillez les confirmer. Vous le pouvez sans blesser les formes; elles sont observées puisque tout le plan Vous a été présenté par le Directoire.
Donnez-nous de même les écoles paroissiales pour les villes. Leur établissement ne coûtera pas de nouvelles sommes. Elles seront prises sur les fonds que les collèges des secours publics de ces provinces livrent annuellement à l’instruction publique. Et ces écoles sont de toute nécessité, sans quoi les enfants entrent dans les écoles de district sans savoir ni lire ni écrire. Nous n’avons plus que deux ou trois écoles de district à ériger pour compléter toute la masse d’instruction projetée dans les gymnases et les écoles de district. Mais si les écoles paroissiales des villes ne vont pas au pair, le premier fondement nous manquera et l’ouvrage restera morcelé. Il ne fait qu’un soit fait ainsi pour se rendre complet. Je joins un extrait des § qui concernent cet objet que Vous Vous êtes fait présenter2 avec le reste par le Directoire. Je ne puis Vous dire avec quelle impatience les amis du bien attendent ces ordonnances de Vous, avec quelle ardeur je les désire. Le temps que j’ai à vivre est très limité. Il est à peine probable que j’atteindrai l’époque où l’instruction publique pour les villes et les campagnes sera entièrement organisée. Ce printemps ma santé souffre plus que jamais et je ne voudrais pas Vous quitter, ô mon Alexandre, avant d’avoir terminé. Mais quand tout cet ensemble sera consolidé, je mourrai avec moins de regret, Vous laissant un souvenir qui Vous rappellera Votre ami d’une manière digne de Vous et de lui.
La pauvre veuve Roth avec ses enfants languit encore dans l’incertitude et l’indigence. Je lui ai promis des secours de Votre part. – Il m’en a coûté, j’ai hésité longtemps à intercéder pour elle – parce qu’elle est ma belle-sœur. Chargé de mes propres enfants et de plusieurs enfants adoptifs, je ne puis la secourir que bien faiblement.
Sonntag n’a point encore de décision sur l’affaire de l’arrende de Colberg. Le Prince Lapuchin ne songera pas de lui-même à Vous la présenter une seconde fois. Votre cœur seul peut lever de pareils incidents.
92. G. F. Parrot à Alexandre IER
[Dorpat, à la fin de mai 1806]1
Mon Alexandre! Homme chéri du Ciel! Je viens de passer quelques heures délicieuses, occupé de Vous. Je voudrais Vous retracer une partie de sentiments qui animaient mon cœur, des idées que m’inspirent Vos nouvelles relations.
Vous allez devenir Père 2. Les peuples confiés à Votre cœur paternel s’en réjouissent. Des millions d’hommes qui attendent leur bonheur de Vous, de Vous seul, en remerciant l’Être Suprême, lui adressent des vœux pour Votre bonheur, pour la conservation de Votre auguste Épouse et du rejeton précieux qu’ils attendent. Vous-même en remerciez l’objet de notre adoration. Vous sentez Votre bonheur en Monarque et en homme. Vous avez sûrement le doux pressentiment de la félicité domestique qui Vous attend, de cette félicité sans laquelle les autres jouissances perdent de leur prix, qui seule peut rendre susceptible de toutes les jouissances. Vous Vous rapprocherez de la Nature et de Vous-même, dont le poste pénible où Vous êtes tente journellement à Vous éloigner. Vous apprendrez à connaître une nouvelle espèce de Vertu qui vous donnera des forces pour exercer toutes les autres.
Vous serez mon Héros dans un sens plus étendu que jamais. – Cette perspective heureuse augmente la masse de bonheur que Vous avez accumulée sur moi. O! que ne puis-je Vous exprimer le sentiment qui agite mon cœur en cet instant! Je crois Vous aimer davantage. Je me transporte en idée auprès de Vous dans ce moment délicieux où Vous avez appris Votre bonheur. Je sens Votre joie, Votre jouissance, je lis dans Votre cœur; j’entends le vœu sacré que Vous avez renouvelé à la Vertu de ne vivre que pour elle et par elle. Je soulève le voile de l’avenir. Je suis présent au moment plus délicieux encore où pour la première fois Vous presserez dans Vos bras ce rejeton précieux que Vous offrirez à Vos peuples comme le garant de leur félicité future, où Vous présenterez à la divinité ce que Vous avez de plus cher, en lui renouvelant l’offrande de Votre propre cœur.
L’idée que je Vous écris m’arrête. Puis-je confier au papier tout ce que je sens, tout ce que je pense? Vous me connaissez. Vous connaissez le vœu secret que Vous m’avez inspiré dès les premiers temps de notre connaissance. Vous me comprenez sûrement, ô mon Ami!
Dans la supposition que ce sera un fils dont Vous serez père Vous avez sûrement déjà songé au plan d’éducation que Vous suivrez. Vous avez tant de motifs d’y songer. Permettez-moi de Vous communiquer quelques idées énoncées brièvement mais mûries et éprouvées par l’expérience. Peut-être nous rencontrerons-nous sur la même route?
L’âge de la première enfance appartient à la Mère. Les besoins physiques de l’enfant, le besoin non moins pressant de la mère de prodiguer ses soins et sa tendresse, indiquent clairement la voie de la nature, qui réserve aux mères le mérite de la première éducation et à nous celui de sentir ce mérite et de nous attacher de plus en plus à celle qui met toutes ses jouissances dans le bonheur commun de la famille. En remettant ainsi la première éducation aux soins de Votre Épouse Vous désirerez peut-être qu’Elle s’acquière elle-même une instruction recherchée, qu’Elle puise dans les livres les règles qu’Elle doit suivre. Il n’existe qu’un livre pour les mères. C’est Emile3. Tout le reste n’est que fatras, mauvais commentaire de cet ouvrage immortel. L’Impératrice l’aura sûrement lu, peut-être plus d’une fois. Mais qu’Elle le lise à présent. À présent qu’Elle sent son enfant sous son cœur, Elle trouvera Emile nouveau, plus intéressant, plus lumineux que jamais. Ce n’est qu’à présent qu’Elle le comprendra parfaitement. Son cœur fera mille commentaires auxquels elle n’a jamais songé.
Vos droits et Vos devoirs commencent au second période de l’éducation, au sortir de la première enfance. Ce période date du moment où l’enfant sent les premières relations sociales, où il s’aperçoit qu’on obéit quand il commande. Il commence de bonne heure pour les fils des Rois. Épiez ce moment. Dès lors Votre devoir de Père serait de veiller au développement des facultés de Votre fils, de soigner toute son éducation. Mais Vous êtes Monarque et Vous ne pouvez pas sacrifier le bonheur présent de Votre nation à son bonheur futur. Il Vous faudra donc un second père à Votre fils. Ce choix Vous mettra en peine, et quoique Jean-Jacques se soit épuisé à prouver l’impossibilité de ce choix, c’est cependant à lui que je Vous adresse pour ce choix. Plus il accumule les difficultés, plus il instruit.
Le système d’éducation que Rousseau a exposé dans son Emile vaut beaucoup mieux que l’auteur ne l’a cru lui-même. Il le croit impraticable dans nos mœurs, et cependant c’est le seul praticable, parce que rien n’est bon, même dans nos relations artificielles, que ce qui est fondé sur les relations naturelles. Basons tout sur celles-ci; les alentours n’auront que trop de soin des autres. Au reste je Vous dois une remarque sur l’application de ce système au cas présent. Jean-Jacques nous enseigne à former un homme qui sache se retrouver dans les relations sociales, mais qui soit indépendant d’elles. Il donne à son élève des talents manuels pour qu’il sache trouver sa subsistance dans les premiers besoins des hommes, dans ces besoins qui existent sous tous les rapports. Il avait en vue la jeune noblesse française abandonnée alors à une éducation plus que féminine. Il pressentait pour ainsi dire la révolution qui a prouvé d’une manière terrible le besoin de ses principes. Emile arraché aux relations de sa naissance, frondant l’opinion et les besoins factices, trouvant sa subsistance et son contentement dans l’atelier d’un menuisier, nous plaît. Mais Emile, fils de Roi, appelé au trône, me paraîtrait bien petit en cet état. Il ne serait à mes yeux qu’un égoïste qui n’eût jamais senti le sublime de sa vocation. L’existence physique ne doit être rien pour un Monarque. Quand il ne saura plus remplir sa place, il n’en doit vouloir aucune autre. L’expérience a prouvé en outre que tous ces Rois qui s’étaient exercés à un métier n’ont été que des tourneurs, des serruriers, des pâtissiers, jamais des Rois. Les exercices gymnastiques sont les seuls qui conviennent à l’héritier d’un trône, parce que la gymnastique est pour le corps ce que la science est pour l’âme.
Rousseau d’un autre côté a trop peu fait de cas des connaissances scientifiques et en outre ce défaut commet souvent dans l’éducation d’un Monarque futur. Le principe ordinaire est qu’un Monarque devrait proprement tout savoir, mais que, comme cela est impossible, il faut qu’il sache un peu de tout. Il résulte de là que le Monarque ne sait rien bien. On veut lui enseigner l’art de régner, et pour cet effet on lui parle à 13 ans de Machiavel ou de l’Antimachiavel4, de Montesquieu et de Smith. Sans connaissances préliminaires, sans jugement formé à saisir les relations compliquées des États on raisonne avec lui sur ces relations sur lesquelles il n’existe même encore aucun système, aucune idée fixe, et l’on espère qu’il gouvernera. Il sera gouverné par les raisonneurs et les faiseurs.
<Tout homme qui veut être quelque chose dans l’État doit acquérir deux espèces de connaissances. Les unes, qui sont le principe des sciences politiques, tirées immédiatement de la nature des choses, doivent lui être enseignées rigoureusement pour former son entendement, et pour lui fournir les bases naturelles des autres connaissances.> Ainsi point de superficie! Point d’encyclopédie! Qu’on circonscrive plutôt l’étendue pour augmenter l’intensité et la solidité. Alors, mûri de ce fond réel, il pourra sans risque se hasarder dans le labyrinthe de la science des États. Il aura le tact formé; sa raison lui fera sentir le vide des systèmes et le ridicule de la présomption.
Appuyer sur des connaissances solides ce n’est pas prêcher le pédantisme. L’histoire de nos jours ne prouve que trop bien que l’art de régner est de même le plus compliqué, et consiste proprement dans l’art d’être fait à tout, de ne tenir à aucune forme, d’être inépuisable en mesures, c.à.d. d’être conséquent, et pour l’être il faut que l’esprit soit nourri et non boursouflé.
Je Vous ai parlé de Vous, et de ce second Vous-même que Vous nous donnerez bientôt – peut-être trop longuement. Mais Vous savez que je Vous aime avec la tendresse d’une mère, avec l’attachement d’un fils. Mon cher Alexandre! – Je vais rentrer encore pour quelques instants dans mon rôle de professeur. Je serai court.
Vous nous avez ôté les Haken5. C’est le premier malheur qui est frappé l’Université, et il est irréparable. Je sais tout ce qu’on Vous a dit pour Vous engager à cette démarche. Mais j’ai tout pesé, longtemps avant que d’autres se soient mêlés de cette affaire; et je dis encore: c’est un grand malheur pour l’Université, un mal pour tout l’Empire. Je Vous en donnerai un jour les détails de bouche, si cela Vous intéresse. Mais le mal est fait, et je ne Vous en parle que pour prévenir un plus grand mal, celui qui menace les écoles paroissiales. Voilà un an et demi que l’on a su traîner la chose. On a su, malgré Votre ordre précis, mutiler le plan que Vous aviez Vous-même envoyé au Directoire, de manière à le rendre impraticable et odieux, et ensuite on l’envoie aux provinces pour avoir leur avis! – Nos gymnases, nos écoles de district sont terminés. Tout est fait pour cette partie, et j’espère d’une manière qui fera honneur à l’Université et même à Votre règne. Mais si on parvient à ruiner le plan des écoles paroissiales, j’avoue que je perdrai tout intérêt aux écoles de toute espèce, j’abhorrerai tout ce que j’ai fait dans cette partie. J’aurai honte de n’avoir pu travailler qu’à faire des savants, tandis que je voulais travailler à faire des hommes. Je Vous supplie par tout ce qui Vous est cher, par cet amour ineffable des hommes qui fait le caractère de Votre cœur, par la postérité qui Vous jugera d’autant plus sévèrement que Vous avez si bien commencé, je Vous supplie de ne rien décider sans m’avoir entendu sur tout ce qu’on Vous présentera. Faites-moi venir à Pétersbourg, pour que je puisse démasquer ouvertement le plan d’iniquité qui mine Votre plan. Je Vous proposerai des mesures qui Vous éviteront sûrement les dégoûts que Vous a causé l’affaire des paysans6. Souvenez-Vous de ce que je Vous ai dit autrefois sur cette affaire. Je Vous ai prédit tous ces dégoûts, toutes ces contradictions qui minent la confiance et ne mettent pas seulement le respect à la place. – Ne prenez pas ce langage énergique pour de la violence. O mon Alexandre! Vous l’avez fait une fois7, et cent fois l’expérience doit Vous avoir prouvé que Vous Vous trompiez.
Le Comte Savadovsky est très malade. S’il meurt, pensez à Klinger pour le remplacer. Il faut une tête à la tête de ce Ministère. Sous lui Dorpat a fleuri et s’est élevé. Sous lui toutes les Universités russes fleuriront et s’élèveront. Donnez-nous Novossilzoff à sa place, puisqu’il n’a pas encore d’Université8. – Novossilzoff! Je souffre beaucoup de savoir que les anciennes relations ne sont plus les mêmes. Je lui ai écrit par le dernier courrier pour lui faire sentir qu’il ne doit pas y avoir de sa faute. Je lui ai parlé en ami, c.à.d. avec rigueur. Il a l’âme noble, le cœur bon; Vous ne devez donc jamais Vous séparer. L’intérêt de la chose publique, c.à.d. Votre propre intérêt, exige que Vous teniez à ce principe, malgré ce que Nov. lui-même pourra Vous dire contre. Je ne parle pas des clameurs de la cour. Ces clameurs ne méritent pas leur place dans une lettre à mon Bien-Aimé.
Vous avez rendu ma belle-sœur heureuse9. Comment Vous en témoigner ma gratitude? Cœur généreux! Vous surpassez toutes les espérances.
Je relis ma lettre. Mon Bien-Aimé la lira-t-il avec plaisir? O Alexandre! Si je t’ai fait de la peine, pardonnez-moi. Tu sais comme je t’aime. Je sens combien tu m’aimes. Mais n’oublie pas l’immense inégalité que le sort a mise entre nous. Tu es tout-puissant. Moi, je n’ai que mon cœur et ma raison.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































